Quand le financement par l’emploi pénalise les actifs modestes
Le 28 août 2025, la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) a publié une étude approfondie sur les dépenses de santé des ménages. Fondée sur le modèle de microsimulation Ines-Omar et sur des données de 2019, elle calcule le « taux d’effort », c’est-à-dire la part de revenu consacrée à la santé sous toutes ses formes : cotisations à l’assurance maladie obligatoire, primes de mutuelle et restes à charge. Résultat : la moyenne atteint 15% du revenu, soit environ 6.800 euros par an et par ménage, mais les disparités sociales demeurent marquées.
La mécanique est connue des économistes de la protection sociale : la santé est financée pour l’essentiel par les revenus du travail. La DREES évalue la part de ces contributions obligatoires à 11% du revenu des ménages, quand la mutuelle pèse 3%, et le reste à charge 1%. L’actif modeste, dont chaque euro de salaire est soumis à cotisation et CSG, consacre donc mécaniquement plus de ressources que le retraité au profil similaire. Pour les bas revenus, l’écart est faible (15% pour les actifs contre 14% pour les retraités), mais la tendance souligne la charge structurelle qui repose sur l’emploi.
Cette configuration explique que le taux d’effort progresse avec le niveau de vie des actifs, mais pas avec celui des retraités. Ainsi, à bas revenu, la mutuelle et les restes à charge font pencher la balance, tandis que pour les salariés modestes, ce sont surtout les cotisations qui creusent l’effort global.
La mécanique est connue des économistes de la protection sociale : la santé est financée pour l’essentiel par les revenus du travail. La DREES évalue la part de ces contributions obligatoires à 11% du revenu des ménages, quand la mutuelle pèse 3%, et le reste à charge 1%. L’actif modeste, dont chaque euro de salaire est soumis à cotisation et CSG, consacre donc mécaniquement plus de ressources que le retraité au profil similaire. Pour les bas revenus, l’écart est faible (15% pour les actifs contre 14% pour les retraités), mais la tendance souligne la charge structurelle qui repose sur l’emploi.
Cette configuration explique que le taux d’effort progresse avec le niveau de vie des actifs, mais pas avec celui des retraités. Ainsi, à bas revenu, la mutuelle et les restes à charge font pencher la balance, tandis que pour les salariés modestes, ce sont surtout les cotisations qui creusent l’effort global.
Les retraités aisés et l’effet « cotisations nulles »
Chez les hauts revenus, l’écart saute aux yeux. Un actif très aisé consacre 18% de son revenu à la santé. Pour un retraité au même niveau de vie, cette part tombe à 11%. « Les retraités très aisés ne consacrent que 11% de leur revenu à la santé. C’est moins que les actifs en emploi avec un niveau de vie équivalent (18%) », indique la DREES. La différence provient de l’absence de cotisations sociales salariales une fois à la retraite, alors même que les besoins médicaux peuvent être accrus.
En revanche, la facture de mutuelle tend à croître après la cessation d’activité, les contrats individuels étant plus onéreux que les contrats collectifs cofinancés par les employeurs. Mais cette hausse reste insuffisante pour compenser la disparition des cotisations salariales, ce qui explique le recul global du taux d’effort. Le paradoxe est donc clair : plus on s’élève dans l’échelle des revenus, plus la retraite allège proportionnellement la contribution à la santé.
En revanche, la facture de mutuelle tend à croître après la cessation d’activité, les contrats individuels étant plus onéreux que les contrats collectifs cofinancés par les employeurs. Mais cette hausse reste insuffisante pour compenser la disparition des cotisations salariales, ce qui explique le recul global du taux d’effort. Le paradoxe est donc clair : plus on s’élève dans l’échelle des revenus, plus la retraite allège proportionnellement la contribution à la santé.
L’autre extrême : ménages modestes et charges insoutenables
Pour une minorité, la contrainte devient écrasante. Le décile le plus exposé consacre 23% de son revenu à la santé, le centile le plus touché monte à 34%. Dans ce groupe, les ménages modestes sont largement représentés. Les auteurs de l'étude le notent : « Les taux d’effort les plus extrêmes […] sont acquittés par des ménages souvent modestes, parfois retraités, parfois en affection de longue durée (ALD) et ayant peu recours à la complémentaire santé solidaire ».
Les chiffres confirment cette charge : en moyenne 2.200 euros de reste à charge pour les 10% les plus exposés, 5.400 euros pour le 1%, et jusqu’à 10.000 euros pour le 0,1%. L’optique, le dentaire et certains soins spécialisés constituent les postes les plus lourds, souvent mal couverts par les mutuelles. Ces montants rappellent que derrière la moyenne nationale, le système produit des extrêmes qui fragilisent les équilibres financiers des ménages les plus vulnérables.
Les chiffres confirment cette charge : en moyenne 2.200 euros de reste à charge pour les 10% les plus exposés, 5.400 euros pour le 1%, et jusqu’à 10.000 euros pour le 0,1%. L’optique, le dentaire et certains soins spécialisés constituent les postes les plus lourds, souvent mal couverts par les mutuelles. Ces montants rappellent que derrière la moyenne nationale, le système produit des extrêmes qui fragilisent les équilibres financiers des ménages les plus vulnérables.
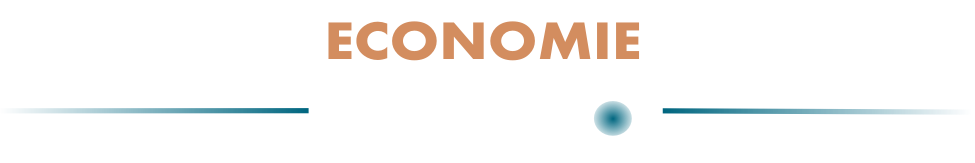
 France
France





