Dette publique : un record en valeur absolue
La dette publique française augmenté de 70,9 milliards d'euros entre avril et juin 2025 et a atteint 3.416,3 milliards d'euros à fin juin 2025, ce qui constitue un record en valeur absolue, d'après les derniers chiffres publiés par l'INSEE. En conséquence, le ratio dette publique/PIB passe à 115,6%, contre 113,9% à la fin du premier trimestre 2025 ; cette progression met en évidence une accélération de l'endettement depuis 2019.
Par ailleurs, la dette nette augmente de 55,5 milliards d'euros sur le trimestre ; cette différence s'explique notamment par une hausse de la trésorerie des administrations publiques (+16,2 milliards d'euros), qui atténue partiellement l'impact de la hausse brute. Autrement dit, malgré une trésorerie plus abondante, l'accumulation des engagements l'emporte et alourdit la charge globale.
Par ailleurs, la dette nette augmente de 55,5 milliards d'euros sur le trimestre ; cette différence s'explique notamment par une hausse de la trésorerie des administrations publiques (+16,2 milliards d'euros), qui atténue partiellement l'impact de la hausse brute. Autrement dit, malgré une trésorerie plus abondante, l'accumulation des engagements l'emporte et alourdit la charge globale.
Pourquoi la dette publique est-elle aussi élevée ?
Plusieurs facteurs conjoints expliquent ce niveau élevé de dette publique : tout d’abord, l'État a fortement contribué à la hausse, avec une augmentation de 64,3 milliards d'euros de sa contribution à la dette au deuxième trimestre 2025, liée à l'émission de titres négociables à long terme (+52,8 milliards d'euros) et à court terme (+8,1 milliards d'euros). Ensuite, des mesures de soutien exceptionnelles (crises sanitaire et inflationniste) ainsi que des baisses de prélèvements non intégralement financées ont accru les besoins de financement.
En outre, une croissance plus faible que prévu pèse sur les recettes : moins d'activité économique signifie moins de rentrées fiscales, or ces recettes manquantes doivent être comblées par de la dette si les dépenses restent soutenues. Ainsi, la conjugaison dépenses soutenues + recettes contraintes favorise une trajectoire ascendante de l'endettement public.
En outre, une croissance plus faible que prévu pèse sur les recettes : moins d'activité économique signifie moins de rentrées fiscales, or ces recettes manquantes doivent être comblées par de la dette si les dépenses restent soutenues. Ainsi, la conjugaison dépenses soutenues + recettes contraintes favorise une trajectoire ascendante de l'endettement public.
Les titres négociables de l'État, les premiers « responsables » de la dette
La hausse de la dette publique est imputable majoritairement à l'État : l'encours des titres négociables de l'État représente l'essentiel de la progression, tandis que la dette des administrations de sécurité sociale augmente aussi (+7,8 milliards d'euros, notamment du fait de l'URSSAF, +11,7 milliards d'euros). Par contraste, la dette des administrations publiques locales reste quasi stable, ce qui indique que l'effort d'emprunt est concentré au niveau central.
Les conséquences budgétaires suivent : avec un stock de dette relevant désormais de 115,6% du PIB, la charge d'intérêts et la sensibilité aux taux deviennent un paramètre prioritaire des décisions. Par ailleurs, le gouvernement doit arbitrer entre maîtrise des dépenses, réformes structurelles et choix de recettes, sachant que tout ajustement brutal peut peser sur la croissance et donc à terme sur le ratio dette/PIB.
Les marchés et les agences de notation surveillent l'évolution de notre dette : la perception du risque s'aligne avec la hausse de l'endettement. Réduire le ratio dette publique/PIB exige soit une compression durable des dépenses publiques, soit une hausse significative et soutenue de la croissance, soit des recettes supplémentaires. Chacun de ces leviers comporte des coûts politiques et économiques : une réduction rapide des dépenses pourrait impacter les prestations sociales, tandis qu'une montée des prélèvements pèse sur la demande. Par conséquent, le chemin de correction est long et se négocie au détriment d'autres priorités budgétaires.
Les conséquences budgétaires suivent : avec un stock de dette relevant désormais de 115,6% du PIB, la charge d'intérêts et la sensibilité aux taux deviennent un paramètre prioritaire des décisions. Par ailleurs, le gouvernement doit arbitrer entre maîtrise des dépenses, réformes structurelles et choix de recettes, sachant que tout ajustement brutal peut peser sur la croissance et donc à terme sur le ratio dette/PIB.
Les marchés et les agences de notation surveillent l'évolution de notre dette : la perception du risque s'aligne avec la hausse de l'endettement. Réduire le ratio dette publique/PIB exige soit une compression durable des dépenses publiques, soit une hausse significative et soutenue de la croissance, soit des recettes supplémentaires. Chacun de ces leviers comporte des coûts politiques et économiques : une réduction rapide des dépenses pourrait impacter les prestations sociales, tandis qu'une montée des prélèvements pèse sur la demande. Par conséquent, le chemin de correction est long et se négocie au détriment d'autres priorités budgétaires.
La question de la dette sera incontournable lors des débats autour du budget 2026
À court terme, cette annonce de l'INSEE pèsera sur l'élaboration du budget 2026 : le gouvernement doit désormais intégrer une dette nominale record et un ratio supérieur à 115% du PIB dans ses projections. Cette donnée renforce la nécessité d'arbitrages sur les dépenses prioritaires et sur la trajectoire de réduction du déficit, tout en tenant compte du risque social et politique associé à des coupes trop brusques.
Par ailleurs, la composition de la dette (taux fixes vs taux variables, maturités) et le calendrier des émissions seront des éléments cruciaux pour contrôler la charge d'intérêts. En conséquence, les choix techniques (gestion de la dette) et les choix politiques (dépenses, prélèvements) devront être coordonnés pour éviter que la dette publique ne devienne un facteur de déstabilisation économique.
Par ailleurs, la composition de la dette (taux fixes vs taux variables, maturités) et le calendrier des émissions seront des éléments cruciaux pour contrôler la charge d'intérêts. En conséquence, les choix techniques (gestion de la dette) et les choix politiques (dépenses, prélèvements) devront être coordonnés pour éviter que la dette publique ne devienne un facteur de déstabilisation économique.
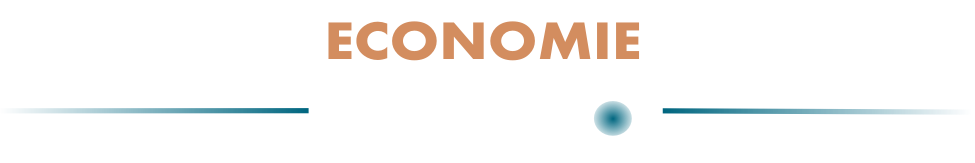
 France
France





