Une hausse conséquente mais controversée
Le budget proposé représente une augmentation substantielle par rapport aux 1,3 trillion d'euros du précédent cadre financier pluriannuel (CFP), en vigueur jusqu'en 2027. Cependant, comme le rappelle la Commission, la comparaison en termes absolus masque une réalité plus complexe. Le nouveau budget, bien que plus élevé, s’établit à 1,26% du revenu national brut (RNB) de l’UE, une faible augmentation par rapport au 1,13% du budget actuel. Mais cette donnée, prisée des analystes économiques, est loin de satisfaire toutes les attentes. Si une partie de l’augmentation est censée être allouée à la défense et à la compétitivité, notamment pour contrer la montée en puissance de la Chine et la menace russe, l’autre partie doit impérativement couvrir les remboursements de la dette collective contractée pour financer le plan de relance post-Covid, un poids supplémentaire qui pourrait bien réduire la capacité d’investissement de l’UE dans d'autres domaines stratégiques.
Un budget pour la défense et l'Ukraine, mais à quel prix ?
Un des principaux axes de ce budget est la sécurité, avec un plan ambitieux d’investissement dans la défense et les technologies spatiales, doté de 131 milliards d'euros. Cette somme représente une hausse colossale, puisque cinq fois plus importante que les crédits actuels. À cela s'ajoute la création d'un fonds spécifique pour la reconstruction de l’Ukraine, avec un montant de 100 milliards d'euros. Bien que cet investissement soit vu comme essentiel pour soutenir l’Ukraine dans sa lutte contre l’agression russe, il suscite aussi des réactions négatives. Certains États membres, notamment la Hongrie et la Pologne, sont particulièrement opposés à ce soutien massif, pointant du doigt l’énorme somme allouée à Kyiv alors que les priorités internes sont de plus en plus urgentes.
Les résistances internes : l’Allemagne en tête
L'Allemagne, première économie de l'Union, s'est rapidement montrée réticente à l'égard de cette proposition, la jugeant « inacceptable » en l’état. Le porte-parole du gouvernement allemand a exprimé que « l'augmentation du budget européen ne peut pas être acceptée à un moment où tous les États membres font des efforts considérables pour consolider leurs propres finances nationales ». De plus, les agriculteurs, dont les organisations ont organisé plusieurs manifestations à Bruxelles, dénoncent les coupes sévères proposées dans la politique agricole commune (PAC), notamment une réduction des fonds consacrés à leurs activités. Le montant alloué aux aides agricoles dans le budget proposé est d'environ 300 milliards d'euros, contre 386 milliards dans le précédent budget. Ce recul est perçu comme une menace pour l'agriculture européenne, déjà en crise en raison de la concurrence mondiale et des exigences environnementales croissantes.
Le défi des négociations à venir
Si le projet de budget est officiellement présenté, il ne sera pas adopté tel quel. En effet, ce plan ambitieux doit encore passer l’étape cruciale des négociations entre les 27 États membres. Ces discussions risquent de devenir particulièrement houleuses, tant les divergences sont grandes. D'un côté, les pays dits « frugaux » – parmi lesquels l’Allemagne, les Pays-Bas et la Suède – plaident pour une réduction des dépenses, mettant en avant la nécessité de respecter les limites budgétaires nationales. De l’autre, les partisans du projet insistent sur la nécessité d'un budget européen renforcé pour affronter les défis mondiaux actuels.
La Commission européenne, consciente des résistances, a cependant plaidé en faveur d’une augmentation modeste des contributions nationales, de l’ordre de 1,13% à 1,15% du RNB des États membres. Mais cela ne suffira peut-être pas à convaincre ceux qui estiment que l’Union européenne doit d'abord résoudre ses problèmes internes avant de se lancer dans des projets aussi ambitieux.
La Commission européenne, consciente des résistances, a cependant plaidé en faveur d’une augmentation modeste des contributions nationales, de l’ordre de 1,13% à 1,15% du RNB des États membres. Mais cela ne suffira peut-être pas à convaincre ceux qui estiment que l’Union européenne doit d'abord résoudre ses problèmes internes avant de se lancer dans des projets aussi ambitieux.
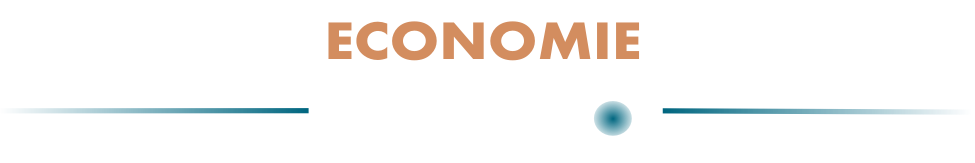
 France
France





