Joseph Stiglitz soutient une taxation des riches plus ambitieuse
Le 1er octobre 2025, Joseph Stiglitz a pris la parole à l’Assemblée nationale pour défendre la taxe Zucman. L’économiste américain, figure de la lutte contre les inégalités, a jugé nécessaire que la France agisse rapidement et sans attendre une coordination internationale. Son intervention s’inscrit dans un contexte où les débats sur la fiscalité des riches occupent une place centrale dans l’agenda budgétaire et politique du pays.
Lors de son intervention, Joseph Stiglitz a rappelé que les grandes fortunes bénéficient en moyenne de rendements annuels compris entre 6 et 10%. Pour lui, un prélèvement de 2% ne saurait constituer un effort insurmontable : « Être imposé à hauteur de 2%, ce n’est vraiment pas beaucoup », a-t-il déclaré. Le prix Nobel a insisté sur le fait que la France avait intérêt à avancer seule si nécessaire, afin de montrer l’exemple et de créer un mouvement international. Il a fait valoir que la taxe Zucman permettrait de réduire les inégalités et de financer des investissements essentiels dans les services publics.
Cette prise de position intervient alors que le gouvernement a récemment écarté le rétablissement de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF). L’exécutif vise à ramener le déficit public à 4,7% du PIB en 2026 tout en excluant une hausse générale de la fiscalité sur le patrimoine. Dans ce contexte, le plaidoyer de Joseph Stiglitz pour une taxation ciblée des très hauts patrimoines a trouvé un écho particulier parmi une partie des députés de la majorité et de l’opposition.
Lors de son intervention, Joseph Stiglitz a rappelé que les grandes fortunes bénéficient en moyenne de rendements annuels compris entre 6 et 10%. Pour lui, un prélèvement de 2% ne saurait constituer un effort insurmontable : « Être imposé à hauteur de 2%, ce n’est vraiment pas beaucoup », a-t-il déclaré. Le prix Nobel a insisté sur le fait que la France avait intérêt à avancer seule si nécessaire, afin de montrer l’exemple et de créer un mouvement international. Il a fait valoir que la taxe Zucman permettrait de réduire les inégalités et de financer des investissements essentiels dans les services publics.
Cette prise de position intervient alors que le gouvernement a récemment écarté le rétablissement de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF). L’exécutif vise à ramener le déficit public à 4,7% du PIB en 2026 tout en excluant une hausse générale de la fiscalité sur le patrimoine. Dans ce contexte, le plaidoyer de Joseph Stiglitz pour une taxation ciblée des très hauts patrimoines a trouvé un écho particulier parmi une partie des députés de la majorité et de l’opposition.
La taxe Zucman au cœur des débats fiscaux en France
La taxe Zucman, du nom de l’économiste français Gabriel Zucman, propose de mettre en place un impôt plancher annuel de 2% sur les patrimoines supérieurs à 100 millions d’euros. Ce seuil vise les détenteurs des plus grandes fortunes, soit une minorité de ménages, mais dont l’impact budgétaire pourrait être significatif. Le dispositif entend cibler la richesse accumulée plutôt que la richesse en formation, et répondre à un déséquilibre : aujourd’hui, la fiscalité du capital représente environ 4% du PIB, un niveau jugé insuffisant au regard des besoins de financement.
Gabriel Zucman a défendu ce projet à l’Assemblée nationale en présence de Joseph Stiglitz et de l’économiste indienne Jayati Ghosh. Joseph Stiglitz a mis en garde les députés contre la tentation d’introduire des déductions ou des exceptions, rappelant que « dès que vous commencez à créer des déductions, des mécanismes… », les dispositifs deviennent inopérants. Pour Gabriel Zucman, la simplicité de la taxe est un atout essentiel pour garantir son efficacité et éviter les stratégies d’évitement fiscal.
Gabriel Zucman a défendu ce projet à l’Assemblée nationale en présence de Joseph Stiglitz et de l’économiste indienne Jayati Ghosh. Joseph Stiglitz a mis en garde les députés contre la tentation d’introduire des déductions ou des exceptions, rappelant que « dès que vous commencez à créer des déductions, des mécanismes… », les dispositifs deviennent inopérants. Pour Gabriel Zucman, la simplicité de la taxe est un atout essentiel pour garantir son efficacité et éviter les stratégies d’évitement fiscal.
Un tournant politique sur la fiscalité des grandes fortunes
Le débat sur la taxe Zucman s’inscrit dans une tension plus large sur la justice fiscale en France. Alors que le gouvernement cherche à réduire son déficit budgétaire, plusieurs économistes soulignent la nécessité de faire contribuer davantage les plus fortunés. En appelant Paris à assumer seule cette réforme, Joseph Stiglitz met en avant l’idée d’un leadership français capable de peser sur la scène internationale. Selon lui, l’adoption d’une telle taxe aurait un effet d’entraînement, incitant d’autres pays européens à emboîter le pas.
L'imposition minimale de 2% sur les grandes fortunes ne constitue pas une entrave au dynamisme économique, étant donné que les rendements atteignent en moyenne 6% par an, a estimé Joseph Stiglitz. Au contraire, un telle taxe renforcerait la légitimité de l’État dans sa capacité à financer les infrastructures, la transition écologique et la réduction des inégalités sociales. De leur côté, les opposants craignent qu'en agissant seule, la France n’affaiblisse son attractivité et ne pousse certaines fortunes à l’exil.
L'imposition minimale de 2% sur les grandes fortunes ne constitue pas une entrave au dynamisme économique, étant donné que les rendements atteignent en moyenne 6% par an, a estimé Joseph Stiglitz. Au contraire, un telle taxe renforcerait la légitimité de l’État dans sa capacité à financer les infrastructures, la transition écologique et la réduction des inégalités sociales. De leur côté, les opposants craignent qu'en agissant seule, la France n’affaiblisse son attractivité et ne pousse certaines fortunes à l’exil.
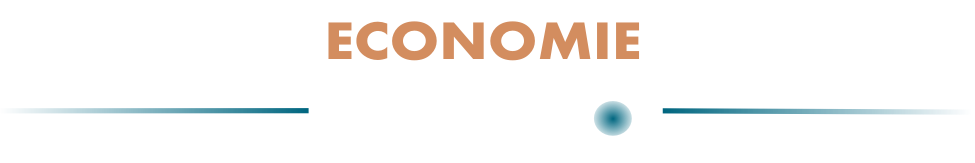
 France
France





